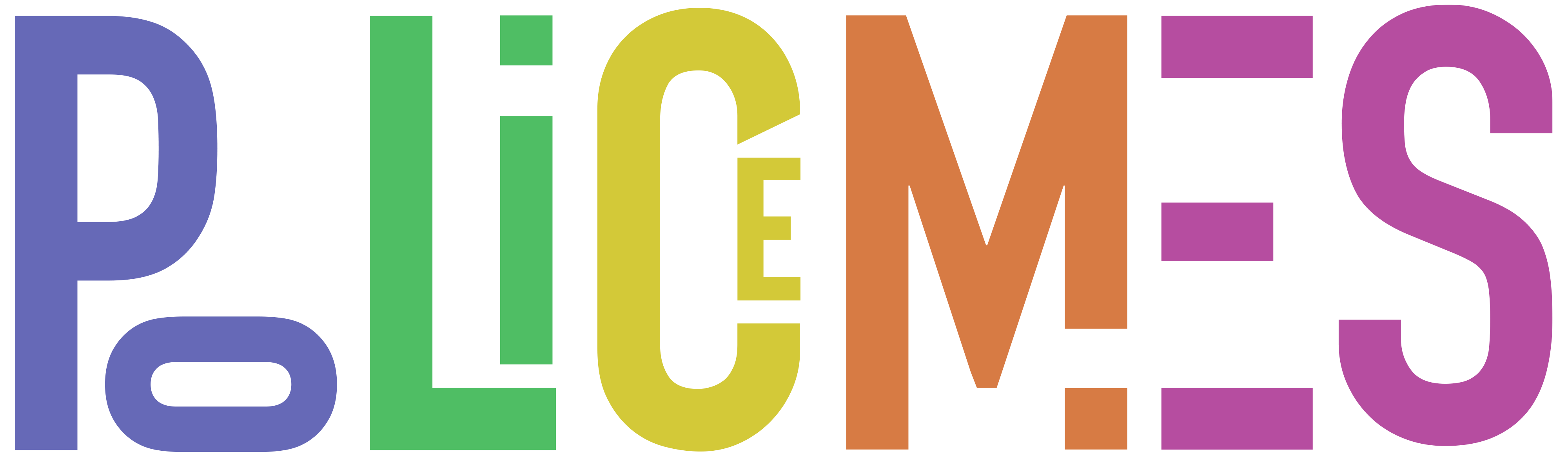Présentation
Publié le – Mis à jour le
Projet scientifique de l’équipe PoLiCÉMIES
1. Contexte du projet
La recomposition des équipes de recherche à La Rochelle Université a incité un ensemble de chercheurs et chercheuses à réfléchir à la place des sciences humaines au sein d’une institution ancrée sur la façade de l’Atlantique Sud et articulée à un partenariat entre universités européennes. Notre objectif est de nous associer aux questions scientifiques que se pose l’Institut du Littoral Durable Urbain et Intelligent (LUDI) à propos des transitions et des défis sociétaux qui découlent de l’anthropisation du littoral. Nos activités de recherche analysent les transitions culturelles liées aux productions artistiques et aux manifestations créatives (notamment dans leur expression numérique et littéraire), aux imaginaires (spécialement présents dans les cultures populaires) ainsi qu’à la circulation des idées et des représentations sociales (en particulier celles issues des dynamiques internationales et des échanges entre espaces océaniques et côtiers).
2. Qui sommes-nous ?
L’équipe de recherche PoLiCÉMIES regroupe des chercheurs et chercheuses en langues, civilisations, sciences politiques, études des media et littératures francophones et étrangères dont les domaines d’expertise diverses sont un apport indispensable à la compréhension des transformations culturelles.
Ainsi, les changements de croyances, de valeurs, de normes ou encore de traditions peuvent être analysées au prisme des relations de pouvoir. Outre l’étude des institutions publiques ou des modes de gouvernance, les corrélations de force se retrouvent, par exemple, dans les évolutions des manières de concevoir l’altérité. L’expansion territoriale du XIXe siècle fut une façon pour des puissances coloniales d’établir que les sociétés « autres » étaient prémodernes, soit de les subalterniser, tout en formulant une série de stéréotypes qui mêlaient fascination et exotisme à leur endroit (Said, 1978). Cette approche ethnocentriste, qui amalgamait des individus à une identité collective, générale et essentialisée et qui répondait à une logique de domination entre empires et colonies, a évolué, voire s’est transformé, au XXIe siècle. Il est en effet possible d’observer l’émergence d’un « orientalisme numérique » (Suat et al., 2021), soit la représentation des cultures, des traditions et des habitants de l’extrême orient à travers des supports et des médias numériques élaborés en Californie (tels que les films, les jeux vidéo, les applications, les réseaux sociaux) dans le but de proposer des biens de consommation dématérialisés et produits en dehors de ces espaces mais dont le contenu perpétue une représentation biaisée et exogène à ces sociétés. Inversement, il est également possible d’observer un « orientalisme inversé » (Slingerland, 2010), décelable dans l’offre culturelle, par exemple, des Instituts Confucius, basée sur une simplification et homogénéisation des expressions culturelles chinoises, telles que la prépondérance du mandarin aux dépends du cantonais ou une version uniformisée du folklore chinois; cette stratégie renforce les idées préconçues à propos de la Chine mais consolide sa stratégie de soft power vis-à-vis de pays sur lesquels elle cherche à exercer une influence commerciale, économique et diplomatique. L’étude des manières et des stratégies de concevoir et de façonner l’altérité permet en somme d’observer comment les expressions créatives, les imaginaires sociaux et les représentations sociales peuvent être de fruit de relations de pouvoir asymétriques.
Les écrivains et les artistes témoignent aussi de l’envie de faire de la pratique artistique une façon de réfléchir au rapport au monde, à le cultiver et à le renouveler. Il s’agit donc de rétablir le dialogue entre les sciences et les arts car comme le dit Antoine Desjardins, auteur d'Indice des Feux (prix du roman d’écologie 2022), « même la fiction la plus réaliste a le potentiel de faire surgir d’autres idées, de transformer notre perception et de contribuer à l’émergence d’autres imaginaires ». Ainsi, le rôle des arts est de montrer et parfois de montrer mieux. Interroger les textes et images permet de dévoiler plus précisément le monde. Ces analyses passent aussi par l’étude de la lecture, des processus d’édition, de publication, et de diffusion des arts, des idées, de la culture et des sciences de la Renaissance à la période contemporaine. De la « genèse de l’homme typographique » (McLuhan, 1962) avec la « révolution de l’imprimé » (Eisenstein, 1983) à celle du numérique et des théories des médias (Mersch, 2018), il conviendra d’étudier les manières dont les médiations diverses et multiples des objets culturels au sens large transforment ces derniers, palliant leur incomplétude et les réinvestissant de significations toujours renouvelées en fonction des contextes (Eco, 1962 ; Kracauer, 1963), mais aussi comment leurs « propagations » (Boullier, 2023) construisent et transforment les individus. L’exploration des processus de médiations des idées s’enrichit également par la spécialisation en gender studies, par définition pluridisciplinaires, tandis que la maîtrise de la science des signes ou sémiologie, qui féconde les études littéraires, permet d’élargir les corpus d’étude à d’autres objets que les textes.
De leur côté, les littératures et cultures populaires, accessibles à un large public, constituent d’excellents vecteurs de médiation scientifique, mais aussi des supports féconds de recherche. Les supports médiatiques sont nombreux : bande-dessinée, cinéma de genre, littérature jeunesse, web séries et séries TV, réseaux sociaux... Certains chercheurs en revendiquent même leur utilisation afin de communiquer avec le public comme Philippe Descola, anthropologue français (Anent : nouvelles des Indiens Jivaros en collaboration avec Alessandro Pignocchi, 2016). De même, dans Un Monde sans fin, l’auteur de BD Christophe Blain interroge et illustre le spécialiste des questions énergétiques et du climat Jean-Marc Jancovici.
Ces différents médias ne sont uniquement des moyens d’illustrer et d’expliquer au plus grand nombre des théories scientifiques complexes. Ils permettent aussi de capter les imaginaires sociaux, de les mettre en récit et en image pour penser le monde de demain. Ainsi, les récits de science-fiction, le cinéma (par exemple : The Day after Tomorrow, Roland Emmerich, 2004, film catastrophe écrit à partir des rapports du GIEC) et les séries d’anticipation (Extrapolation, Apple TV, 2023 qui met en scène des scénarios de prospective basés sur les rapports récents du GIEC), et de genre (Scali Bertil et De Andreis Raphael, Mer, 2022, roman policier écologique qui se déroule dans un Bordeaux sous les eaux en 2050 et décrit de manière réaliste et documentée scientifiquement les effets du dérèglement climatique) constituent des corpus d’étude de ces imaginaires. La critique dite “environnementale” peut aussi être enrichie par une variété d’approches pluridisciplinaires comme l’écocritique, l’écoféminisme et les nature writing.
3. L’équipe de PoLICÉMIES
Depuis plusieurs années, les chercheuses et chercheurs de PoLiCÉMIES imaginent et construisent des collaborations scientifiques qui ont donné lieu à des projets de recherche, et de nombreuses publications. Faisant sienne la dynamique de décloisonnement de la recherche qui est la signature de notre établissement, la nouvelle équipe considère que les bouleversements sociétaux générés par les transitions numériques, énergétiques et environnementales ne peuvent faire l’économie de l’analyse des contextes socio-culturels qui les voient naître.
L'équipe regroupe des chercheurs et chercheuses dont l'objet d'étude est constitué par les productions matérielles et immatérielles — qu'elles soient artistiques, culturelles ou littéraires — de communautés aux intérêts divers. En se focalisant sur leur émergence, leur création, leur production, et leur circulation dans le contexte du LUDI, PoLiCÉMIES vise l'observation et l'analyse des transformations sociales et sociétales ouvertes par le double défi du littoral durable et des transitions culturelles.
L'étude des cultures à travers leurs structures, productions, et usages permettent d'analyser et de comprendre dans leur complexité les transitions culturelles. Celles-ci mettent en évidence le réseau complexe d'interactions à l’origine de la création, de même que la nécessité d’en renouveler l'approche méthodologique afin de permettre une compréhension plus globale des phénomènes. Elles trouvent leur matérialité scientifique dans un concept que les chercheuses et chercheurs de l'équipe placent au cœur de leurs préoccupations : celui de propagation (Boullier, 2023). Relativement nouveau dans les humanités, ce paradigme englobe les entrées évoquées plus haut. Les phénomènes de propagation, largement travaillés par les sciences exactes, et en particulier par la biologie, exposent et révèlent des processus qui pourraient s'avérer constitutifs de la réalité sociale. Le défi posé par la « désinformation » (information erronée), sa fabrication et sa circulation, les modes de réappropriation et de transformation qui nous confrontent, entre autres, aux risques du relativisme, est un exemple de ce type de phénomène, et de la nécessité pour la recherche d’avoir une vision systémique et transdisciplinaire.
Les visions kaléidoscopiques offertes par le dialogue entre nos disciplines ouvre en effet des réflexions multiples. De ce fait, le choix de l’acronyme (Politique, Littératures, Cultures, Écritures, Médialité, Idées, Expressions, Sciences) témoigne, par l’allusion homonymique avec « polysémie », de la multiplicité des significations. Ainsi, l’objet d’étude « LUDI », investi de tous ses sens possibles, sera envisagé en tant que système dans sa globalité et sa complexité grâce aux concepts et outils heuristiques de diverses disciplines dont le dialogue promet une forte valeur heuristique ajoutée.
4. Médiations et réceptions
La notion de médiation renvoie à l'ensemble des dispositifs, des techniques et des pratiques qui permettent de mettre en forme les messages, de les diffuser et de les mettre à disposition des publics. Les chercheurs de l'équipe PoLiCÉMIES travaillent sur ces questions en se focalisant sur les pratiques de médiation qui permettent de faire circuler les idées dans l'espace public. Ils cherchent à comprendre comment les dispositifs de médiation influencent la circulation des idées et comment ils contribuent à la construction des imaginaires collectifs.
L’étude de ce domaine a été initiée :
- Insitorium (Financement Région Nouvelle Aquitaine, dispositif Eventech 2017-2019 pour un montant de 53k€) : recherche-création sur le développement d’un casque sonore immersif avec géolocalisation centimétrique.
- Médiation culturelle et robotique pour musées (Financement international - Innovart 2017-2019 pour un montant de 40k€) : recherche-création sur les dispositifs robotiques de médiation pour le Museum, en partenariat avec le laboratoire L3i.
- Bonpland, une archive augmentée (Financement international - Innovart 2020-23 pour un montant de 90k€) : recherche-création sur les technologies immersives, les récits non-linéaires et les systèmes de navigation pour les archives du naturaliste rochelais Aimé Bonpland.
- Système de navigation en environnement immersif pour les archives du naturaliste Aimé Bonpland (contrat doctoral 2020-2023).
- Biolaboratoire mobile en Arts et Sciences (Financement national – Parc National Marin de la Gironde et de la mer des Pertuis 2019-22 pour un montant de 42k€) : recherche-création sur les relations entre les arts et les sciences au travers d’un dispositif mobile de médiation en contexte littoral.
- Plateforme Franco-Argentine de Médiation Arts, Sciences et Technologies – MAST (financement international – Innovart 2024-2027 pour un montant de 90k€) : recherche autour de la création et le commissariat d’exposition arts et sciences.
- NANOmusée (Financement MESR 2022-25 pour un montant de 651k€) : Sur la base des expériences et des résultats du projet de biolaboratoire, nous avons soumis une proposition dans le cadre de la labellisation SAPS qui consiste à développer et produire un musée mobile, le nano-musée.
- Animation scientifique et projets à investir
4.1 Animation scientifique et projets à investir
Ces nombreux projets financés ont déjà permis de riches collaborations. Cette dynamique nous motive à créer des projets communs articulés à un espace d’animation scientifique régulière. Ces projets et cet espace associeront les chercheurs et chercheuses de l’équipe, ainsi que des invités provenant d’autres laboratoires de La Rochelle Université ou d’autres universités, mais également des étudiant·es en Master Direction des projets audiovisuels et numériques et en Master Langues, cultures et affaires internationales (parcours Asie/Pacifique et parcours Amériques)
4.2 Animation scientifique
Participeront à cette animation scientifique collaborative des activités de recherche (séminaires, journées d’études, colloques, publications, etc.) et des événements en lien avec la vulgarisation scientifique (festivals, rencontres, projections…) qui proposeront une approche systémique des sujets interrogés. À titre d’exemple, l’équipe a la volonté de d’organiser un festival culturel annuel nommé « PoLiCÉMIES dans la cité », envisagé comme un moment de présentation des travaux mais aussi d’échange avec le grand public. Celui-ci pourrait trouver sa place dans la programmation des journées LUDI.
4.3 Projets scientifiques à investir
Européens :
- Un projet sur la Gamification (ou ludification) de la « misinformation » est en cours de dépôt, en partenariat avec SETU, l’Université de Copenhague, Cambridge University.
Nationaux :
- Projet « Asie-Pacifique Amériques (APA) ». Celui-ci vise à structurer un domaine de recherche pluridisciplinaire sur la dynamique des échanges au sein de l’espace du Pacific Rim (des deux côtés de l’Océan Asie-Pacifique) qui relie l’Amérique à l’Asie-Pacifique afin de répondre à des appels à projets de recherche collaborative entre entités publiques dans un contexte international proposés par l’Agence nationale de la recherche en 2025. Ainsi, dans une perspective comparative, POLICÉMIES s’intéressera en particulier aux échanges à l’échelle du Pacific Rim, sur la base d’une collaboration depuis plusieurs années avec le laboratoire D2IA.
Région Nouvelle Aquitaine :
- Colloque international « Études Transpacifiques », Octobre 2024, La Rochelle Université. Cet événement s’inscrit dans les activités APA et servira de base au projet ANR en 2025.
- 2022-2025 Région Culture (120K).
Établissement (ACI LUDI) :
- Colloque international « Études Transpacifiques », Octobre 2024, La Rochelle Université. Cet événement s’inscrit dans les activités « Asie/pacifique Amériques » (APA) et servira de base au projet ANR en 2025.
- Colloque international « Quand les cultures populaires crient au réveil climatique », 2024-25.